Un peu de désunion avec Vladimir Pozner
Voilà, c'est fait. Je viens de croiser ma dernière grande rencontre "livresque" de 2009. Ce sera Vladimir Pozner dont je viens de lire "Les Etats-Désunis", livre initialement paru en 1938 et véritable pépite que viennent de rééditer les éditions Lux (Editeur du Québec, spécialisé dans l’édition d’ouvrages d’histoire sociale et politique des Amériques, qui vient de faire son apparition en France par le biais de la diffusion d'Harmonia Mundi).
De Vladimir Pozner, je ne savais rien, pas même le nom. Pour se familiariser avec lui, je vous propose le texte qu'Alain Garric lui a consacré en 1985 dans Le magazine littéraire à l'occasion de la parution d'un nouveau roman (a).
Avec une recherche formelle novatrice (Daniel Pozner, dans la présentation de cette nouvelle édition, définit ce livre sur les Etats-(dés)Unis comme un portrait cubiste de l'Amérique), Pozner nous raconte la vie quotidienne de Harlem, les briseurs de grève de l’agence Pinkerton, la guerre des journaux à Chicago, les héros déchus de Hollywood, les grèves violentes dans les mines de Pennsylvanie, John Dos Passos et Waldo Frank, le courrier du cœur et les écrivains publics, le marchand de lacets de Wall Street, les gangsters et les croque-morts, le racisme et la peine de mort... C'est l'image d'une Amérique en crise qu'à la lecture, j'ai souvent mis en parallèle avec "Les raisins de la colère" de Steinbeck (notamment le superbe chapitre sur la vente de Cadillac aux familles démunies, qui se séparent de tout ce qui a fait et fait leur vie pour réunir les quelques dollars nécessaires à l'achat d'une voiture déglinguée, qui doit leur permettre de rejoindre la Californie où des tracts affirment qu'on a besoin de main d'oeuvre)... Souvent aussi, c'est à Scorsese que j'ai pensé.
Les Etats-Désunis, ce sont les fêlures d'un monde qui s'écroule, travaillé, érodé par les malaises dans la civilisation et les tendances mafieuses. J'y ai vu, lu, les fractures que l'hyper-capitalisme occidental a tenté de ressouder depuis 1979, avec trente ans de vie à crédit et d'approfondissement de la rupture du lien entre le producteur et le consommateur, de cet hyper-capitalisme qui vient, à nouveau, de vaciller. N'omettons point la dimension admirative que garde Pozner pour le peuple américain. Une multitude de bonnes raisons de lire (ou relire) aujourd'hui ce livre, grand ouvrage littéraro-journalistique (c'est affreux mais parlant) dans la lignée des plus grandes renommées du genre.
Impressionné par "Les Etats-désunis", je me suis commandé deux autres livres de Pozner, deux romans que Babel (le poche d'Actes Sud) nous propose encore : "Le mors au dent" et "Les brumes de San Francisco".
Puisque nous venons de quitter Lawrence Sterne, je ne résiste pas à citer l'exergue retenu par Pozner pour ses brumes de San Francisco. Comment ne pas avoir envie de se plonger dans le roman après s'être placé sous une (c)ouverture pareille? :
" Il est bien évident que je ne fais pas un roman, puisque je néglige ce qu'un romancier ne manquerait pas d'employer. Celui qui prendrait ce que j'écris pour la vérité serait peut-être moins dans l'erreur que celui qui le prendrait pour une fable." Denis Diderot "Jacques le fataliste"
Je ne résiste pas non plus à vous reproduire le récit d'une rencontre avec Cendrars qui ouvre "Le mors au dent" (Cendrars dont la collection "Les têtes brulées" est à l'origine de ce roman) :
" La dernière fois que j'ai vu Blaise Cendrars, il ne m'a pas reconnu. Cela se passait à l'enterrement de Fernand Léger, au mois d'août 55. Paris était vide d'hommes et plein de fleurs, il y avait plus de fleurs que d'hommes au cimetière de Gif-sur-Yvette. D'abord Nadia Léger avait cru que son mari n'aurait pas voulu de fleurs, rien d'autre qu'un drapeau rouge sur son cercueil. Elle avait fini par changer d'avis, il y a eu le drapeau rouge et les fleurs, pas de couronnes, des gerbes seulement. Le soleil brûlait, il y avait des fruits aux branches des arbres; à l'entrée du cimetière, à l'ombre d'un pommier, rassemblée autour d'une moto rutilante, une famille d'ouvriers était descendue tout entière d'une toile de Léger.
Cendrars se tenait au fond, près de Nadia; je lui ai trouvé l'air vieilli. J'ai dit : "Bonjour", il a levé sur moi des yeux soûls de douleur, et j'ai compris qu'il ne me reconnaissait pas. Cela faisait une vingtaine d'années que nous ne nous étions pas revus, j'avais dû changer, moi aussi. J'ai pensé que le moment était mal choisi pour des retrouvailles, et que j'allais lui téléphoner un autre jour.
C'est que nous nous étions souvent rencontrés aux environs de 1930. Il ne mettait pas longtemps à se lier avec les gens, sans doute parce qu'il en avait connu beaucoup, et de toute espèce. Il m'invita chez lui, au Tremblay. Sa lettre, comme toutes celles que je devais recevoir de lui, se terminait par ces trois mots : "Ma main amie"."
(a) Texte d'Alain Garric dans Le magazine littéraire en mars 1985 :
" Peau Rouge d’adoption, il a encadré sa photographie entre les portraits de Crazy Horse et de Little Big Man. Drôle d’Indien. Né à Montparnasse, témoin de la révolution d’Octobre, scénariste à Hollywood, Vladimir Pozner déterre la plume de fête à quatre-vingt ans et part sur le sentier de l’écriture romanesque, l’œil fendu par les éclats du siècle, fière grimace, semblable à celle que Dame-Soleil imprima sur le visage des premiers occupants de l’Amérique. Il a tout vu et connu tout le monde, les livres d’histoire moderne lui tiennent lieu de biographie. Il s’est initié à tailler les mots auprès de Gorki, a rencontré Elsa bien avant Aragon et quand il lui a plu de se souvenir (Mille et un jours, ou Vladimir Pozner se souvient), il raconta Brecht, Chaplin, Chklovski, Ivanov, Joris Ivens, Fernand Léger, Mauriac, Pasternak, Picasso, J.R. Oppenheimer ou Dashiell Hammett. Echantillon d’un coffre à la Stevenson renforcé par mille liens. Ainsi, il accéda par sa première femme, qui peignait, à Robert Musil dont l’épouse tenait une galerie à Berlin. Et avec qui se remaria-t-il ? Une comédienne, ayant quitté Hambourg pour Paris et qui occupait une chambre de bonne dans un hôtel de la rue de Tournon où vivait, bien entendu, Joseph Roth. Inépuisable, Pozner est de ceux qui vous font visiter une bibliothèque courant à travers tout un appartement (ici, rue Mazarine) et concluent le trajet par une remarque : « En fait, mes livres sont à la campagne ».
Flottant dans un pull-over archéologique et un jean hors d’âge (il ferait vieux baba s’il avait quarante ans de moins), Vladimir Pozner a l’élégance de ceux que les coïncidences de la vie habillent sur mesure. Preuves rapides : fils d’émigrés russes, il arriva à Pétersbourg, où son père pouvait alors revenir, en 1909, il avait quatre ans. A l’école, dans la ville qui devint Petrograd puis Leningrad, Vladimir et son frère se firent deux amis : les fils de Kerenski. Quelques années plus tard, ils eurent pour camarades deux frères encore, les fils de Lev Davidovitch Bronstein dit Trotski. Bien sûr, il a vu Lénine, par de semblables occasions et, à travers les fenêtres de l’appartement familial, les manifs d’ouvriers et de marins marchant vers la Douma, le galop de cosaques sur la Perspective Nevski, en 1917. Maxime Gorki venait dîner à la maison et les Pozner lui rendaient visite le dimanche. Pourquoi pas ? Premier au concours de circonstances, Vladimir.
En
France, son père, journaliste-historien, avait publié les nouvelles
illégales du régime tsariste. Dans les années 30, le fils, rédacteur
français de l’émigration allemande, rendit publiques les illégales
nouvelles du IIIème Reich. En 1933, Vladimir adhéra au PCF et l’idée
tombe de lui en demander la raison. Communiste d’un rouge personnalisé,
comme une cuvée de propriétaire, il fut le seul à qui l’OAS livra, en
1962, une petite boîte rose. Le même jour où une petite fille perdit un
œil dans l’explosion de l’immeuble d’André Malraux, une bombe ouvrit le
front de l’auteur du Lieu du supplice. A moins que la blessure
ne remontât à Wounded-Knee ou Sans-Creek et à un coup de sabre Yankee.
Une indienne aurait pu l’imaginer, un jour de 1937, à l’angle du
Boulevard Raspail et de la rue de Rennes. Cheveux noirs, pommettes
hautes, une femme le suivit et l’aborda : « You are an Indian ». Elle
prononça le nom de son peuple. Déconcerté, Vladimir, qui n’avait croisé
des Peaux-Rouges que dans Fenimore Cooper, n’entrevit que le côté
littéraire et abstrait de la situation. L’Indienne, « convaincue que
j’avais honte », dit-il, tourna les talons de ses mocassins , « sans
laisser entendre le moindre bruissement, comme si elle marchait dans
l’herbe printanière », écrit-il, cette fois dans son nouveau livre (Les Brumes de San Francisco).
Car,
dès cette rencontre, Pozner se mit à lire tout ce qu’il put trouver sur
les Cherokees et, en 1938, entreprit une traversée des Etats-Unis,
restituée aujourd’hui dans une fiction qu’il voulut élaborée « en
action ». 1938 : le 1er Octobre, la Wehrmacht entrait en
Tchécoslovaquie. 1838 : le 1er Octobre commençait la déportation des
Cherokees vers le futur Oklahoma, cette tribu qu’une variole avait
décimée, un siècle plus tôt – en 1738. Dans le secret des chiffres,
Pozner remonte comme un saumon vers son identité (celle de son
narrateur ?). Songe d’une nuit de l’Ouest où, aux figures de Tom
Sawyer, Jim Bridger, Sarah Winchester se superpose, dans les brumes et
la fumée de tabac, le profil de La jeune fille au turban de Vermeer. Depuis soixante-quinze ans qu’il tape à la machine et enfonce les touches de son Hermès noire, le scénariste de La Dame aux camélias
ne sait toujours pas si c’est dans la rue que les visages se lisent ou
s’ils apparaissent entre les pages de ce qui s’appelle, « comment
dit-on ? un roman ? » "


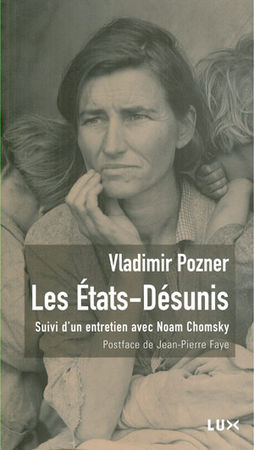

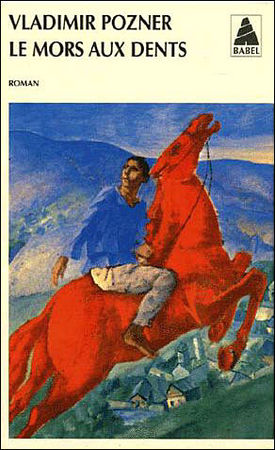



/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F97%2F66%2F656811%2F63872845_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F04%2F97%2F656811%2F62121190_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F20%2F71%2F656811%2F62018740_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F54%2F47%2F656811%2F45306979_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F88%2F08%2F656811%2F44313760_o.jpg)